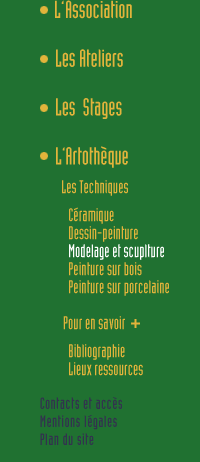|
Le modelage est une technique qui consiste à assembler un matériau (terre, cire ou plâtre) à la main, pour réaliser un objet (le plus souvent de petite ou moyenne taille). Ce procédé permet l’ajout ou la suppression de matière à tout moment , et donc le repentir (contrairement à la sculpture proprement dite). |
||||||||||
L'argileDoté de ce matériau, deux types d’objets peuvent être créés : objet en terre crue, c’est-à-dire celle qui n’a subit aucune cuisson, et objet en terre cuite qui présente un objet cuit et aux nombreuses variétés (grès, porcelaine, faïence). Les outils les outils les plus courants sont : - les ébauchoirs : qui laissent des stries (s’il s’agit d’un ébauchoir denté) ou qui lissent la terre (avec un ébauchoir droit) - les mirettes : pour enlever le surplus de matière, pour évider ou creuser - le fil à couper : pour couper une motte de terre - le pinceau : pour la finition de l’objet notamment
sans oublier quelques accessoires bien utiles comme : - la tournette : plateau tournant sur lequel on pose l’objet en cours de réalisation - le vaporisateur : qui permet d’humidifier la terre - les linges et sacs en plastiques : pour protéger et conserver l’objet |
||||||||||
Les techniques
|
||||||||||
| Le montage des formes Plusieurs techniques de montage existent là encore : - le montage dans la masse : il s’agit de prendre dans sa paume de main une boule de terre et de montée la pièce en évidant la terre. - le montage au colombin : le pot (puisque cette technique est essentiellement pratiquée en poterie) se monte au fur et à mesure grâce à la superposition de boudins de terre - le modelage à la plaque : ici, ce sont des plaques de terre obtenues par l’étalement du matériau par un rouleau. Le travail s’élabore en dressant et en soudant ces plaques entre elles. - le montage par estampage ou coulage dans un moule : technique qui autorise l’obtention de plusieurs exemplaires d’un objet à partir d’un modèle.
Pour monter certaines pièces, il est parfois nécessaire de renforcer la structure de l’objet par le biais d’armatures en bois ou en fer.
|
||||||||||
La cuisson La cuisson n’est pas une obligation (terre crue). Avant toute cuisson, la pièce de terre doit présenter une voire plusieurs ouvertures afin que l’air de l’intérieur puisse s’échapper.La première cuisson est appelée « dégourdi » ; une seconde cuisson (non obligatoire) peut ensuite être faite. Pour effectuer ces cuissons, différents types de fours existent. Ils se démarquent par leur forme (four armoire, four cloche, four puits) et par leur mode de chauffage (four au bois, au gaz, à l’électricité, au pétrole).
Le décor
|
||||||||||
| • Le moulage Le moulage est considéré comme une technique complémentaire du modelage. Par le biais d’un moule dans lequel on coule un matériau liquide, l’empreinte de l’objet initial est prise pour parvenir à une pièce souvent plus résistante. Les outils Le matériel principal est celui du moule qui peut être flexible (gélatine, caoutchouc, etc.) ou rigide (en plâtre, en polyester, en terre). L’autre composant important dans la technique du moulage est l’agent de séparation. Comme son nom l’indique, sa fonction est de pouvoir séparer facilement le moule du matériau introduit. Le savon mou, la terre glaise sont des exemples de ce type de lubrifiant. Les techniques Tout d’abord, un moule « femelle » est réalisé autour du modèle (pièce originale). Ce dernier est ensuite extrait du moule. A cette étape, le moule est ensuite recomposé s’il n’était pas monobloc pour que l’on y coule à l’intérieur le matériau choisi de la copie. Par ce qu’il est liquide, il va prendre la forme exacte de l’original et pourra être démoulé une fois durcit. |
||||||||||
| • La sculpture La technique de la taille est apparue dès la préhistoire avec la découverte progressive de plusieurs matériaux qui restent aujourd’hui les matériaux traditionnels : le bois, la pierre et le métal. Quelques régions de la planète s’attachent plus aux matériaux d’origine végétale (os, ivoire). Nous l’avons vu plus haut, le modelage est un parent de la sculpture. Mais la sculpture se détache du modelage par certains points techniques indiscutables : le matériau est souvent dur ce qui implique une certaine force physique pour le sculpter, la forme de la pièce n’effectue en supprimant de la matière, on ne peut donc en rajouter (sauf dans le cas d’un assemblage entre pièces métalliques par exemple) ni revenir en arrière. Deux types de sculpture: - la technique du relief (bas-relief, haut-relief) : la profondeur de la sculpture varie, mais reste toujours accolée à un plan - la technique de la ronde-bosse : dans ce cas, la sculpture est totalement indépendante et l’on peut tourner tout autour d’elle pour en admirer toutes les facettes. |
||||||||||
| Le bois Ce sont majoritairement les feuillus qui sont utilisés dans la sculpture. Il est nécessaire, avant toute chose, de faire son choix de bois en fonction de ce que l’on souhaite obtenir comme type de sculpture : regarder donc la dimension du bloc de bois (veut-on une petite ou grande sculpture et de quelle forme), son aspect, et sa résistance (fait pour l’intérieur ou l’extérieur ?). Les outils Les outils sont nombreux. Les principaux sont : ciseaux, gouges, fermoirs, burins, rapes, outils de fixation, scies. Les techniques Le séchage du bois : Quelque soit le type de bois, il faut s’assurer qu’il est bien sec avant de le travailler pour éviter qu’il ne se fendille plus tard. Le séchage est un séchage naturel et un séchage à l’air chaud. La taille du bois : La taille exige un minimum d’expérience, tant au niveau de la technique que du matériau en lui-même. Il est conseillé de bien étudier la forme du bloc, d’examiner l’orientation des fibres, pour ensuite dessiner la forme du bloc au fusain ou à la craie. Ce n’est qu’ensuite que l’on pourra s’attaquer à la taille : procéder au dégrossissage puis définir le modelé de la sculpture de plus en plus finement Pour ceux qui le souhaiteront, une finition pourra être envisagée telle le polissage ou la coloration du bois.La conservation de la pièce en bois sera à examiner également. La pierre La pierre offre au sculpteur nombre de variétés : les roches ignées (comme le basalte, la diorite, le granite, l’obsidienne, le porphyre), les roches métamorphiques (telle la stéatite, l’ardoise, ou le marbre) et les roches sédimentaires (comme l’albâtres, ou le grès par exemple).
Les outils En voici quelques-uns : la boucharde, la gradine (pour enlever les couches successives de la pierre), le ciseau plat (qui aplanit les surfaces), le pic de carrier (marteau utilisé pour dégrossir les pierres dures), limes et rapesmais aussi les masques et lunettes de protection (pour éviter d’inhaler les poussières minérales dégagées lors de la taille de la pierre). Les techniques Deux méthodes sont utilisées : - soit la méthode directe : le sculpteur taille directement dans la pierre, la forme se dégage petit à petit, - soit la méthode indirecte : le sculpteur cette fois fait appel au procédé de reproduction de la mise au point. Une finition de la sculpture grâce au polissage peut être effectué pour rendre la pierre plus lisse et plus brillante et faire ressortir le grain ou les veines. Il se fait à la main ou avec une polisseuse électrique. |
||||||||||
| Le métal L’utilisation du métal en sculpture remonte à la préhistoire. Les métaux les plus utilisés sont : le bronze, la laiton, le fer, l’acier, le plomb, l’aluminium, l’étain, l’or, le platine et l’argent. Ce qui les caractérise : leur dureté, leur ductilité (c’est-à-dire la propriété à pouvoir être étirés en fils sans se déchirer), la ténacité, la résistance à la corrosion, la température de fusion. Les outils Il y a les outils de base : les limes et de râpes (plates, rondes, carrées, etc.), scies à métaux, pinces, clés anglaises, marteaux, cisailles, règle, équerre, burins, etc. ; Le matériel lourd (exemple : l’enclume) et le matériel électrique (foreuse, meule, ponceuse, …) ; et enfin l’environnement de travail (exemple : établi fixe ou une table de travail). Les techniques Les techniques de mise en forme se divisent en quatre types : - la technique du forgeage : le métal est rougi dans une forge, puis poussé à sa température qui le rend malléable pour être ensuite travaillé grâce à un marteau jusqu’à ce que la forme souhaitée soit obtenue ; - la technique de la fonte (fonte au sable, à la cire perdue, etc.) : le métal est porté à sa température de fusion dans un creuset, liquéfié et enfin versé dans un moule négatif où le refroidissement le solidifie. La pièce de métal est ensuite dégagée de son moule pour que le travail de sculpture puisse d’effectué à froid jusqu’à l’aspect désiré ; - la technique du repoussé : la mise en forme du métal se fait par martelage ou battage et à froid ; - la technique de soudage : permet d’assembler plusieurs pièces métalliques grâce à la chaleur. Des techniques de patines pour les métaux existent également. Elles permettent de les colorer superficiellement grâce à une action chimique artificielle (agents chimique corrosifs) ou un séjour prolongé soit dans la terre, soit dans la mer soit à l’air libre. On peut également polir et laquer un métal. Depuis peu, de récents matériaux comme les ciments et bétons font l’objet de sculptures. |
||||||||||
| • Pour en savoir+ |